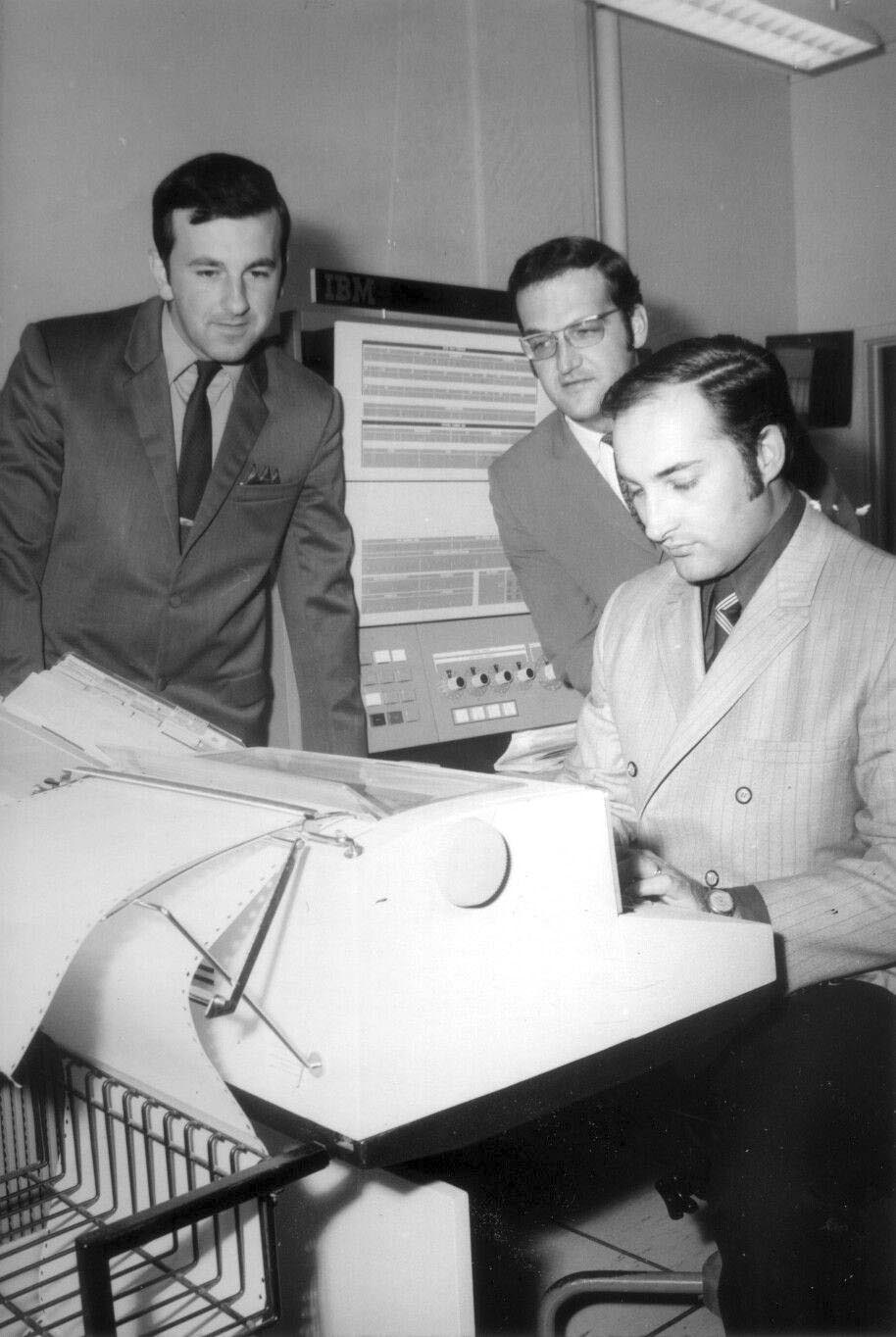Au cœur d’un drame conjugal
L’horloge indiquait 23 h 30. Tout était calme dans la maison en ce milieu de décembre
de 1982. Nicole venait de se coucher et je me préparais à faire de même. J’arrivais
dans l’embrasure de la chambre, lorsque j’entendis cogner à la porte. Surpris, je
regardai ma femme qui n’était pas encore endormie.
- Qui c’est ça? dit-elle, stupéfiée. À cette heure de la nuit!
Sans que j’aie eu le temps de réagir, de nouveaux coups se firent entendre, plus
insistants. Nicole se blottit au milieu du lit, pressant la pile de couvertures contre
elle. À nouveau, les bruits de cognement se répétèrent, mais de plus en plus fort. Un
sentiment de frayeur nous traversa.
- Au secours! cria une voix féminine. J’ai besoin d’aide.
Nous étions sidérés, comme dans un demi-sommeil. Rapidement, je me dirigeai vers la
porte et tassai le rideau pour découvrir une voisine en état de crise.
- C’est Jocelyne, criai-je à Nicole.
Tenant compte du froid glacial qui nous avait incités à demeurer à l’intérieur pendant
une bonne partie de la journée, je m’empressai d’ouvrir la porte et la fis entrer. On
faisait face à une situation irréelle. Chaussée de simples pantoufles rembourrés en
mouton que sa démarche avait recouverts de neige, notre voisine semblait n’avoir enfilé,
pour couvrir sa jaquette, qu’un simple manteau qu’elle n’avait même pas pris le temps
de boutonner. Ses cheveux, balayés par le vent, couvraient partiellement un visage rougi,
à la fois par le froid, la honte, la peur et la colère.
- Aidez-moi, répéta-t-elle. Jean-Réal est à l’intérieur. Il a un fusil. Il est en boisson.
Mon fils de cinq ans est avec lui. J’ai peur qu’il arrive un malheur.
Et elle éclata en sanglots.